Un programme de recherche fondamental et appliqué
Le programme de recherche que je développe depuis 2007 se centre sur un dialogue entre travaux empiriques, méthodologiques et théoriques pour que chaque terrain de recherche alimente la construction d'un modèle théorique liant les concepts de croyance, connaissance, norme et valeur.
Ma démarche se caractérise par un dialogue interdisciplinaire fécond entre la sociologie, l'histoire, les sciences de l'information, la philosophie et l'épistémologie. Mes travaux sur les processus d'adhésion et de désadhésion, qu'ils concernent les croyances extrêmes, la défiance vaccinale, l'infodémie médicale, ou l'acceptation de nouvelles technologies (mobilité autonome, intelligence artificielle), s'inscrivent dans une théorie générale de la diffusion sociale qui constitue le fil conducteur de mon parcours de recherche. J'ai développé un cadre analytique original permettant de comprendre comment se construisent, se propagent et se transforment les croyances et connaissances dans différents contextes sociaux, des mondes 'réels' aux espaces sociaux 'virtuels' (réseaux sociaux).
Par ailleurs, mon programme de recherche s’oriente vers la théorie sociologique en ce que je vise à construire des modélisations de grands concepts comme les croyances, les normes sociales et les valeurs, ainsi que leur diffusion, afin de construire une théorie unifiée de l’activité sociale en prenant comme illustration divers sujets comme les croyances marginales, l’activité scientifique, l’antivaccinisme ou les innovations. L’objectif que je me suis fixé est d’unifier les théories déterministe, fonctionnaliste, interactionniste et individualiste au sein d’une modélisation épistémologiquement solide tout en veillant à ce qu’elle ait une portée pratique et applicable à tout contexte social.
1- Le premier versant, la modélisation des croyances, est issue de ma thèse de doctorat soutenue en 2010;
2- Le deuxième versant, la modélisation des normes sociales est le produit de l’habilitation à diriger des recherches (HDR) soutenue en 2020 menée sur les normes de scientificité ;
3- Le dernier versant, la modélisation des valeurs, est en cours d’élaboration.
3 Projets de recherche en cours

Acceptation des usages numériques face aux risques climatiques
2025-2028
Projet DIBIM « Approche collaborative de gestion des digues interconnectées aux infrastructures urbaines vis-à-vis des risques techniques et économiques via la structuration, l'exploitation et le partage des données en BIM entre gestionnaires et exploitants »
Co-responsable du work package 2 avec Corinne Curt (Laboratoire Risques, ECOsystèmes, Vulnérabilité, Environnement, Résilience - RECOVER, INRAE, UMR 1467)
Résumé : Etude du partage de données par les gestionnaires de digues, premiers remparts face aux risques climatiques, et de l'usage de jumeaux numériques.

Méthodologie et épistémologie des réseaux de neurones
Depuis 2021
Développement de méthodes de deep learning (utilisant l'intelligence artificielle) appliquées aux données textuelles exploitées en sciences humaines et sociales
Les objectifs de ce projet, sur le long cours, sont d'explorer et tester les méthodes de deep learning à l'usage des données textuelles exploitées dans les enquêtes sociologiques menées par ailleurs. Il s'agit de produire une analyse méthodologique des limites et avantages de l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) et de développer une épistémologie de la donnée et de l'IA.
Publication associée :
• Sauvayre R., Gable J. S. M. & Chauvière C., (2022) « An Analysis of French-Language Tweets About COVID-19 Vaccines: Supervised Learning Approach », JMIR Medical Informatics, Vol. 10, No 5, e37831. DOI:10.2196/37831
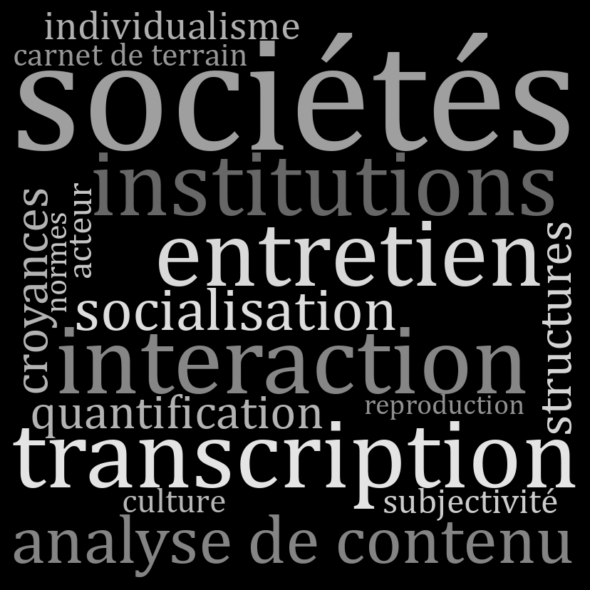
Méthodes d'enquête en sciences sociales
Depuis 2007
Developpement de méthodes d'enquête qualitatives et quantitatives pour venir à l'appui des recherches en sciences sociales
Les objectifs de ce projet, sur le long cours, sont d'explorer les travaux d'autres disciplines comme la psychologie sociale et cognitive, les sciences sociales computationnelle, l'informatique et les mathématiques afin d'améliorer les méthodes utilisées en sciences sociales, et en sociologie en particulier.
Publications associées :
• Sauvayre R. (2022), Introduction to interviews in social sciences, North American Business Press, 218 pages.
• Sauvayre R. (2021), Initiation à l’entretien en sciences sociales. Méthodes, applications pratiques et QCM, 2e. ed., Paris, Armand Colin (collection Cursus), 208 pages.
• Sauvayre R. (2013), Les méthodes de l’entretien en sciences sociales, Paris, Dunod, 153 pages.
• Sauvayre R. (2010), « Mémoires, oubli et émotions. La question de la fiabilité des témoignages dans les enquêtes de sciences sociales », Revue des sciences sociales, n° 44 “La construction de l’oubli”, p. 110 118.
14 Projets de recherche achevés

Adhésion à une mobilité innovante en zone rurale
2022-2025
Projet TERAVA « Processus d'adoption des véhicules autonomes en territoire rural »
Co-responsable du projet avec François Marmoiton (Institut Pascal, UMR 6602)
Résumé : Le projet vise à explorer les habitudes et contraintes en termes de mobilité dans les zones rurales puydomoises (peu denses et très peu denses) afin d'identifier les facteurs susceptibles de favoriser l'adoption de nouveaux modes de mobilités innovantes. L'enquête emploie des méthodes mixtes (entretien semi-directif, focus groups, ethnography design, questionnaires)
Publication associée :
• Gable J. S. M. et Sauvayre R. (2025), « Le rapport à la mobilité autonome en milieu rural : Enquête mixte auprès des habitants du Puy-de-Dôme », Rapport de recherche, Institut Pascal & Laboratoire de Psychologie Sociale et Cognitive.

Diffusion numérique des promesses de guérison à destination des patients atteint d'un cancer
2024
Résumé : En 2022, l'OMS a recensé près de 10 millions de décès du cancer au niveau mondial. En France, le cancer est la première cause de mortalité masculine et la deuxième féminine. Malgré les traitements conventionnels, 24% à 88% des patients cancéreux recourent aux médecines alternatives et complémentaires (MAC), cherchant à atténuer les effets secondaires, participer à leur guérison et renforcer leur immunité. Les compléments alimentaires et la phytothérapie sont particulièrement populaires mais, contrairement aux idées reçues, peuvent compromettre l'efficacité des traitements conventionnels. Notre étude analyse l'exposition des patients atteint d'un cancer aux promesses de guérisons accessibles sur Internet.
Publication associée :
• Sauvayre R. (2025), « Risques d’exposition aux promesses de guérison sur Internet : le cas des soins alternatifs à destination des patients atteints d’un cancer », Rapport d’activité 2022-2024, Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES), p. 217-223.

Les effets de la médiatisation des accidents de véhicules autonomes sur les messages partagés sur le réseau social Twitter (X)
2022-2024
Projet NLP-VA « Analyse de sentiments (NLP) du discours portant sur les véhicules autonomes des utilisateurs du réseau social Twitter »
Co-responsable du projet avec Cédric Chauvière (Laboratoire de Mathématiques Blaise Pascal, UMR 6620)
Résumé : Le projet vise à explorer les évolutions du contenu de l'information postée et diffusée sur Twitter (X) de 2012 à 2022 relatives aux avancées d'une technologie innovante : les véhicules autonomes. Les analyses sont réalisées au moyen de réseaux de neurones artificiels.
Publication associée :
• Sauvayre R., Gable J. S. M., Aalah A., Fernandes Novo M., Dehondt M., Chauvière C., (2024) « The Impact of Autonomous Vehicle Accidents on Public Sentiment: A Decadal Analysis of Twitter Discourse Using roBERTa », Technologies, 12(12), 270. DOI : 10.3390/technologies12120270.
.svg)
Les mécanismes de l'adhésion à une mobilité innovante, le véhicule autonome ou à conduite automatisée
2021-2025
Projet AAVA « Acceptabilité et acceptation des véhicules autonomes : de l'intention à l'action »
Responsable du projet
Résumé : Le projet vise à explorer les facteurs favorisant l'acceptation d'une technologie innovante (véhicule autonome) en fonction de données socio-démographiques, des représentations et croyances, et de l'expérimentation de cette technologie par les usagers. L'enquête emploie des méthodes mixtes : entretiens, questionnaires, observations participantes et expérimentations.
Publication associée :
• Sauvayre R., Gable J. S. M., Aalah A., Navarro J. (2023), « Acceptabilité et acceptation des véhicules à conduite automatisée en fonction du rapport aux outils intelligents et à la résistance au changement des Français », Rapport de recherche n°3, Projet AAVA, Laboratoire de Psychologie Sociale et Cognitive & Laboratoire d’Étude des Mécanismes Cognitifs, 106 pages.
• Gable J. S. M., Sauvayre R., (2022), « Le rapport des Français aux véhicules autonomes : Enquête nationale de l’acceptabilité mesurée par questionnaire », Rapport de recherche n°2, Projet AAVA, Laboratoire de Psychologie Sociale et Cognitive, 62 pages.
• Sauvayre R., Gable J. S. M., et al. (2022), « Etat des connaissances sur l’acceptabilité et de l’acceptation des véhicules autonomes », Rapport de recherche n°1, Projet AAVA, Laboratoire de Psychologie Sociale et Cognitive & Institut Pascal, 65 pages.

Les effets des mesures sanitaires (pass sanitaire et obligation vaccinale) sur les citoyens francophones : analyse de la diffusion de l’acceptation et du refus des politiques publiques sur le réseau social Twitter (X)
2021-2022
Résumé : Pour contenir et freiner la propagation du covid-19, les gouvernements ont utilisé différentes stratégies (confinement, vaccination obligatoire, passe sanitaire, passeport immunitaire, distanciation sociale, etc.). Cette étude vise à examiner les effets de l’annonce d’une décision politique contraignante présentée par le président de la République française, Emmanuel Macron, le 12 juillet 2021. Il annonça notamment l’imposition de la vaccination obligatoire aux soignants et l’obligation de disposer d’un pass sanitaire pour accéder aux restaurants, cinémas, bars, etc. Pour mesurer les effets de cette annonce, 901 908 tweets uniques postés sur Twitter entre le 12 juillet 2021 et le 11 août 2021 ont été extraits du réseau social. Un réseau de neurones artificiels a été construit pour examiner les arguments des tweets et pour identifier le type d’arguments utilisés par les utilisateurs de Twitter. Cette étude montre que le débat sur la vaccination obligatoire et sur le pass sanitaire a mobilisé majoritairement des arguments contestant ces mesures (47 %) et des arguments « scientifiques » (39 %). De plus, il est apparu qu’une décision politique basée sur des arguments scientifiques conduit les citoyens à les contester en utilisant des arguments pseudo-scientifiques contestant l’efficacité de la vaccination.
Publication associée :
• Gable J. S. M.*, Sauvayre R.*, Chauvière C., (2023) « Fight against the mandatory of the Covid-19 immunity passport on Twitter: Natural Language Processing Study », Journal of Medical Internet Research, 25:e49435 (* égales contributions). DOI: 10.2196/49435

Etude de la diffusion d'un 'remède miracle' à base de javel contre la covid-19 sur le réseau social Twitter (X)
2021-2022
Résumé : La pandémie de COVID-19 a donné naissance à toutes sortes de croyances, théories et explications, qu'elles soient scientifiques, religieuses ou conspirationnistes. Au début de la pandémie, la science ne disposait pas encore de remède pour cette nouvelle maladie. Cette article vise à étudier la diffusion d'un "remède miracle" à base de dioxyde de chlore, un agent de blanchiment pour les textiles ou le papier qui possède également des propriétés désinfectantes (eau, surfaces). Les messages francophones postés sur le réseau social Twitter (X) du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2021 ont été analysés à l'aide de graphes de connaissances (Gephi) et croisés avec une analyse scientométrique. Les résultats montrent que les messages promouvant la désinformation, même s'ils sont susceptibles d'être quantitativement moins nombreux, se propagent plus largement que ceux basés sur des informations plus fiables. En outre, cet étude montre que le dioxyde de chlore a été promu comme un remède efficace par des médecins et des articles évalués par des pairs, ce qui a par conséquent augmenté la diffusion de cette croyance dans l'espace social. Ce faisant, la frontière entre science et désinformation devient floue au point qu'il n'est plus possible jusqu'à preuve du contraire de qualifier le dioxyde de chlore de "faux remède miracle", mais plutôt de traitement controversé contre la COVID-19.
Publication associée:
• Sauvayre R. (2023), « Dissemination of a “Fake Miracle Cure” Against Covid-19 on Twitter: the case of the chlorine dioxide », Social Sciences, 12(6), 320. DOI:10.3390/socsci12060320.
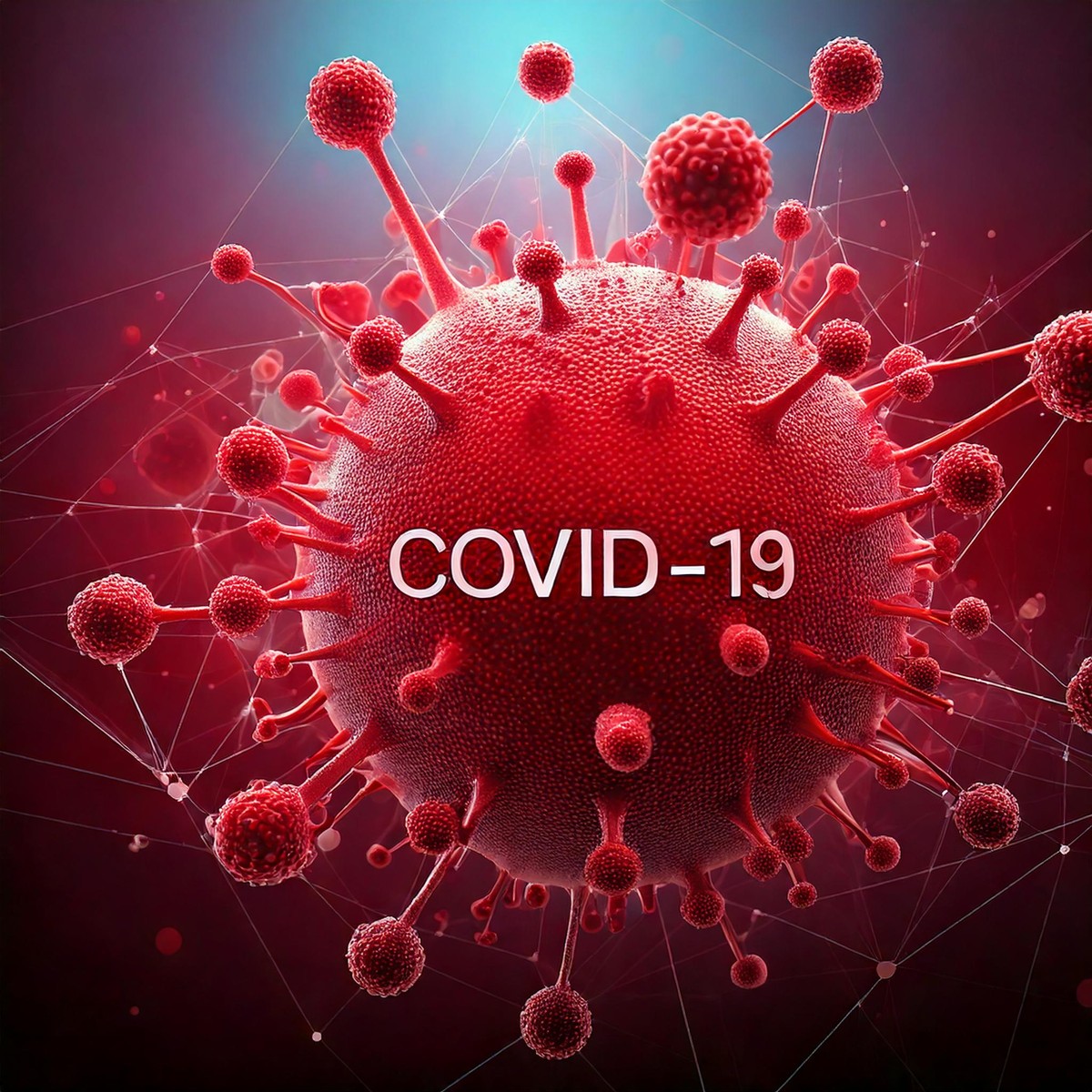
Covid-19 : Diffusion médiatique d’une controverse scientifique. Le cas d'hydroxychloroquine
2020
Résumé : La pandémie générée par la Covid-19 frappa plus spécifiquement la France à partir de février-mars 2020. Ce fut également le moment où les premiers espoirs de traitement furent portés par Didier Raoult promouvant la chloroquine comme un traitement efficace. Depuis, les études les plus rigoureuses ont montré l’inefficacité de ce traitement. Toutefois, un débat sur l'hydroxychloroquine dépassa les seules sphères des articles académiques pour se dérouler devant les citoyens. Ce débat occasionna des questionnements profonds sur la science et sa validité, mais également sur l’éthique du chercheur. Cette recherche vise à retracer les moments clés et les effets de cette histoire des plus contemporaines.
Publication associée :
• Sauvayre R., 2020, « Retour sur le débat médiatique et éthique concernant le traitement contre la Covid-19 à base de chloroquine », Les Cahiers de l’Espace Éthique, Hors-série n° 2, p. 91-92.

Etude socio-historique de la diffusion de la défiance contre le vaccin contre la rougeole : controverse scientifique, diffusion médiatique et prolifération sur les réseaux sociaux
2019-2021
Résumé : Le refus vaccinal est à présent considéré, depuis 2019, comme une urgence de santé par l’Organisation mondiale de la santé. Les épidémies autrefois endiguées sont à présent plus fréquentes du fait du refus vaccinal, premier rempart contre la propagation de cette maladie. Pourtant la communauté scientifique est sans appel : le vaccin contre la rougeole ne provoque par l’autisme des enfants inoculés. Or, la peur vis-à-vis de ce vaccin perdure. Il s’agit ici de remonter aux origines de cette croyance anxiogène. D’abord initiée par le gastro-entérologue britannique Andrew Wakefield, cette thèse fut relayée massivement par les médias et âprement discutée par la communauté scientifique de 1998 à 2004, avant de voir son auteur accusé de fraude. Comment les scientifiques, les journalistes et les parents se forgent-ils leur conviction alors que la communauté scientifique est aux prises avec une vive controverse ? Quelles incidences ont eu ces discussions dans l’espace médiatique, scientifique et judiciaire au cours des années jusqu’à conduire à une résurgence sans précédent de la rougeole et limiter la campagne de vaccination contre la Covid-19 en 2020-2021 ? L'étude montre comment la confiance en la recherche et les risques perçus ont été les principaux moteurs de la diffusion médiatique de la défiance vis-à-vis du vaccin contre la rougeole. Puis, dans un deuxième temps, les sphères conspirationnistes ont participé à sa diffusion sur Internet puis les réseaux, aidé par des personnages publics de grande renommée. A l'aube de la pandémie de Covid-19, une contre-culture anti-vaccinale avait proliféré massivement pour faire le lit du rejet du nouveau vaccin anti-Covid-19
Publications associées:
• Sauvayre R. (2023), Le journaliste, le scientifique et le citoyen. Sociologie de la diffusion de la défiance vaccinale, Paris, Hermann, 190 pages. Livre primé en 2023 par l'Institut de France (Académie des sciences morales et politiques)
• Sauvayre R. (2023), « Obligation vaccinale : quand l’histoire nous invite à réfléchir sur le présent », in Israël-Jost V., Weil-Dubuc P.-L. (dir.), Éthique vaccinale. Ce que nous a appris la crise sanitaire, Toulouse, Erès, p. 145-156.
• Sauvayre R. (2021), « Ethics of belief, trust and epistemic value. The case of the scientific controversy surrounding the measles vaccine », Journal of Leadership Accountability and Ethics, Vol. 18, n°4, p. 24-34. DOI : 10.33423/jlae.v18i4
• Sauvayre R. (2019), « Éthique de la croyance, confiance et valeur épistémique. Le cas de la controverse scientifique entourant le vaccin contre la rougeole », Revue Française d’Ethique Appliquée, n° 8, p. 47-61. DOI : 10.3917/rfeap.008.0047.

Le processus de diffusion des normes de scientificité dans l’espace médiatique et scientifique : le cas de travaux neuro-scientifiques controversés
2017-2020
Habilitation à diriger des recherches
Résumé : Ce travail de recherche repose sur le suivi sociohistorique de la diffusion d’une étude menée en neuroscience cognitive. Celle-ci a la particularité d’avoir réalisé une neuroimagerie fonctionnelle, non pas d’un sujet humain vivant, mais d’un saumon mort. Il s’agit de retracer, au moyen d’une approche abductive (Peirce, 1998), le parcours de la diffusion médiatique et scientifique de cette neuroimagerie hors norme afin de comprendre et d’expliquer son succès. Cela nous mena au cœur d’une controverse méthodologique et normative alimentée et diffusée par plusieurs collectifs de chercheurs, mis au jour par leurs pratiques de citations. Enfin, cette étude sociologique documentaire, scientométrique et lexicométrique, nous conduisit vers une réflexion plus générale d’épistémologie des neurosciences centrée sur le processus de validation scientifique, le tissu normatif l’entourant, et les valeurs inhérentes à la communauté scientifique impliquée. Nous avons alors montré que cet objet singulier – la neuroimagerie d’un saumon mort – révèle une dynamique sociale spécifique qui nous conduisit vers une analyse épistémologique des pratiques de recherche et des normes scientifiques, jusqu’à l’élaboration d’une modélisation conceptuelle liant normes et valeurs scientifiques.
Publications associées:
• Sauvayre R., (2023) « ’Voodoo’ science in neuroimaging. How a controversy transformed into a crisis », Social Sciences, Vol. 12, n°1, 15. DOI:10.3390/socsci12010015
• Sauvayre R. (2022), La face cachée des neurosciences. Sociologie de la diffusion de la neuroimagerie d’un saumon mort, Toulouse, Éditions Érès (Collection Recherches en Éthique Appliquée), 272 pages (version remaniée du mémoire original de la HDR soutenue en 2020).
• Sauvayre R. (2022), « Misreferencing practice of Scientists: Inside Researchers’ Sociological and Bibliometric Profiles », Social Epistemology, Vol. 32, n°6, p. 719-730. DOI : 10.1080/02691728.2021.2022807
• Sauvayre R., (2022) “Types of Errors Hiding in Google Scholar Data”, Journal of Medical Internet Research, Vol. 24, n°5, e28354. DOI: 10.2196/28354
• Sauvayre R. (2022), « La diffusion scientifique et médiatique des neurosciences. Le cas de la neuroimagerie d’un saumon mort », Revue européenne des sciences sociales, n°60-2, p. 129-155. DOI : 10.4000/ress.9178
• Sauvayre R. (2020), De la diffusion scientifique aux normes de scientificité, Habilitation à diriger des recherches : Sociologie, Paris, Sorbonne Université, 3 vol., 737 p.
Vol. 1 Ouvrage original inédit : De la diffusion scientifique aux normes de scientificité. Approche épistémologique et abductive de la neuroimagerie d’un saumon mort (407 p.)
Vol. 2 : Mémoire de synthèse de l’activité scientifique : La diffusion à l’étude : des méthodes aux concepts (95 p.)
Vol. 3 : Ensemble des travaux scientifiques de 2009 à 2020 (235 p.)

La diffusion des prophéties prédisant la fin du monde sur Internet et dans les médias de presse écrite
2017
Résumé : Depuis des siècles, notre histoire est régulièrement scandée par des prédictions annonçant la fin du monde. Ces prophéties génèrent des effets divers sur ceux qui s’en saisissent. Qu’ils soient athées, croyants, profanes, chercheurs ou journalistes, elles ne laissent pas indifférentes. Les sentiments qu’elles suscitent vont de l’inquiétude, à la peur, en passant par la curiosité, l’indignation ou la moquerie. Même si chaque prophétie se révèle systématiquement démentie par les faits, d’autres ne manquent pas d’être annoncées et suivies par une partie de la population. Ce sont les ressorts de ce succès répété qui sont examinés dans cette étude. Qu’est-ce qui amène une catastrophe annoncée à être attendue par la population et relayée par la presse écrite ? Quelles sont les conditions du succès d’une prophétie dont l’échec semble pourtant inévitable ?
Publications associées:
• Sauvayre R. (2019), « Fin(s) du monde : les conditions du succès », in Gauvrit N. & Delouvée S. (dir.), Des têtes bien faites. Défense de l’esprit critique, Presses Universitaires de France, p. 139-158.
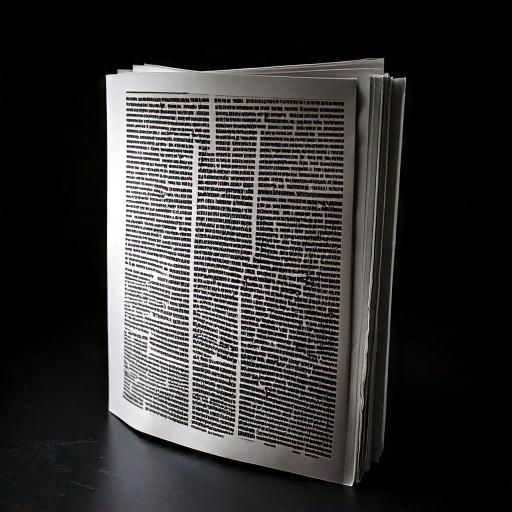
Diffusion du concept de connaissance chez les philosophes des sciences avec cartographie des liens intellectuels, de Platon à Peirce
2014-2016
Résumé : Comment comprendre la construction et la diffusion du concept de connaissance jusqu'à dresser à présent une frontière étanche entre croyance et connaissance. Ce projet pose la question de la diffusion d'un concept au travers des siècles de philosophie jusqu'à sa supplantation par la méthode expérimentale.
L'analyse qualitative des textes montre que le concept de connaissance avait des contours différents dans les siècles passés et que deux écoles de pensées se partageaient l'hégémonie de la diffusion dans les cercles de pensée. Les formes modernes du concept incluent le rapport à la preuve, alors qu'elles se référaient davantage à une forme de religiosité avant l'avènement de la méthode expérimentale.

Comment la médiation scientifique alimente les croyances : étude sur la diffusion du savoir
2014
Résumé : Quel impact a la science sur la formation des croyances ? La lecture des arguments présents dans les doctrines rédigées et largement diffusées de deux mouvements que sont le kardecisme et le mouvement New Age permettra de déterminer le statut de la science aux cœurs de leurs croyances.
Il apparaît une dialectique entre valorisation et disqualification de la science. La science est d’abord mobilisée et valorisée par les auteurs ésotériques afin de donner de la valeur à leur discours. Le recours à la science ouvre également le champ des probables et permet aux auteurs de mobiliser des arguments corrélatifs fallacieux permettant aux adeptes de considérer leur doctrine comme probable ou possible. Dans un second temps, la science est disqualifiée afin de disqualifier tout discours contestataire provenant des scientifiques.
Publication associée :
• Sauvayre R. (2014), « Comment la science alimente les croyances. La surprenante dialectique entre convocation et disqualification du discours scientifique », in Rasplus V. (dir.), Sciences et pseudoscience. Regard des sciences humaines, Paris, Éditions Matériologiques, p. 81-93. DOI : 10.3917/edmat.raspl.2014.01.0081

Usages et représentations des technologies de l’information et de la communication (TIC)
2011-2012
Projet DEVOTIC "Déconnection volontaire aux technologies de l'information et de la communication (TIC)"
Post-doctorante
Résumé : Devant les nombreuses sollicitations par courriels ou par téléphone (portable ou fixe), comment les agents de collectivités territoriales en plein changement organisationnel font-ils face au stress induit par un flux communicationnel incessant ? Quelles sont les pratiques vertueuses en la matière et les solutions possibles à mettre en place ? Les freins constatés dans les usages des technologies de l’information et de la communication sont-ils liés à des connaissances préalables, des représentations ou des rumeurs anxiogènes ? L'enquête emploie des méthoses mixtes : entretiens, observations et questionnaire administré auprès de 945 agents détenteurs d'une adresse électronique au sein de la collectivité territoriale CDAPP/ Ville de Pau.
Publication associée :
• Sauvayre R. (2012), « Les usages des TIC au sein de la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées et de la Ville de Pau », Pau, Laboratoire SET – Université de Pau et des Pays de l’Adour, 107 pages

Modélisation du processus d’adhésion et d’abandon aux croyances extrêmes
2007-2010
Thèse de doctorat
Récompensée par 3 prix de thèse
Doctorante
Résumé : Les travaux de Kuhn (1962) en philosophie des sciences tout comme ceux de Festinger (1957) en psychologie sociale sous-tendent de nombreuses interrogations quant à la dynamique à l’œuvre dans les processus d’adhésion à une idée, une croyance, un savoir nouveau, et à l’abandon des croyances et connaissances antérieures. Ces études esquissaient l’idée selon laquelle les démonstrations de chercheurs au sein de la communauté scientifique, ou le démenti factuel de la croyance au sein d’un mouvement ufologique ne conduisent pas mécaniquement à une révision des savoirs ou des croyances. Si divers travaux de psychologie, de sociologie, de philosophie, d’intelligence artificielle ou d’économie peuvent éclairer la dynamique des représentations sociales ou de la révision des croyances, les mécanismes de l’abandon de la croyance et les modèles présentant le processus de l’adhésion à la désadhésion restent encore méconnus ou incomplets.
Cette thèse a visé l’élaboration d’une modélisation du changement de croyances (adhésion, maintien et abandon). S’appuyant sur la biographie de la croyance d’ex-adeptes ayant adhéré à des croyances « invraisemblables » de toutes obédiences (inspiration chrétienne, bouddhiste, philosophique, spiritualiste, de développement personnel, guérisseur et ufologique), cette recherche aborde la place occupée par la perception, l’expérience sensorielle, la confiance, les normes, les valeurs, les représentations et les émotions dans le processus incrémentiel du changement de croyances (considérées comme des connaissances par les enquêtés). Trois dimensions y sont explorées : le processus d’adhésion à des croyances « invraisemblables » majoritairement considérées comme fausses, le maintien de ces croyances ou « résistance au changement de croyances » malgré les preuves ou les démentis factuels présentés à l’adepte, et la rupture de l’adhésion conduisant l’adepte à céder aux injonctions du doute au profit de la remise en cause de ses convictions les plus profondes.
La modélisation ainsi produite, en prenant appui sur les travaux de philosophie, de psychologie, d’anthropologie et d’intelligence artificielle, permet alors de comprendre et de saisir le caractère rationnel des actions et raisonnements de l’homme ordinaire qui peut être perçu comme irrationnel dès lors qu’il adhère ou ne renonce pas à des croyances perçues comme « invraisemblables ».
Publications associées :
• Sauvayre R. (2017), « The rationality of belief change and the unexpected effects of a conflict of values », Rationality and Society, Vol. 29, Issue 3, p. 298–321. DOI: 10.1177/1043463117717231
• Sauvayre R. (2013), « Quand l’expérience explique l’absence de remise en cause des croyances », Raison Présente, n°188 « Croyance et connaissance », p. 23-33. DOI: 10.3406/raipr.2013.4501
• Sauvayre R. (2012), Croire à l’incroyable, Paris, Presses Universitaires de France, 407 pages (version remaniée de la thèse de doctorat soutenue en 2010).
• Sauvayre R. (2012), « Croyances et rationalité cognitive : les effets des contradictions ordinaires sur la révision des croyances », in Erckert G., Michon B., Vivarelli C. (dir.), La croyance : de la théorie au terrain. Mise en perspective des approches néo-wéberienne issue de la phénoménologie et de l’anthropologie existentiale, Paris, Hermann, p. 53-81.
• Sauvayre R. (2011), « La croyance à l’épreuve : une dialectique émotionnelle et cognitive », in Aden J., Grimshaw T., Penz H. (dir.), Teaching Language and Culture in an Era of Complexity : Interdisciplinary Approaches for an Interrelated World/Enseigner les langues-cultures à l’ère de la complexité : Approches interdisciplinaires pour un monde en reliance, Bruxelles, Peter Lang, p. 121-134.
• Sauvayre R. (2011), « Le changement de croyances “invraisemblables” : essai de modélisation », in Pévet P., Sauvayre R. et Tiberghien G. (dir.), Les sciences cognitives. Dépasser les frontières disciplinaires, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, p. 97-107.
• Sauvayre R. (2010), « Contradictions factuelles, doutes et rupture des croyances défiant le sens commun : une dynamique contre-intuitive », in Guy B. (dir.), Ateliers sur la contradiction. Nouvelle force de développement en science et société, Paris, Presses des Mines, p. 303-312.
• Sauvayre R. (2010), Le processus d’abandon des croyances défiant le sens commun, Thèse : Sociologie, Strasbourg, Université de Strasbourg, 427 p.